Le vent agite mollement les tiges de lin. J’admire l’ondée circulaire qui se forme et s’évanouit comme un rêve.
J’ai emporté avec moi un carnet, un morceau de charbon, deux couteaux bien aiguisés, une petite faux et une lourde couverture que j’ai tricotée l’hiver dernier. Le cheval trépigne et m’indique qu’il est temps d’aller relever mon piège à poissons. Ce soir, si de pauvres malheureux se sont faits prendre, je les préparerai avec des pommes de terre et des carottes froides, quelques aromates et un trait de citron.
Un léger basculement de bassin : voilà le signal qu’il attendait. Il s’élance à toute allure en laissant derrière nous un brouillard de terre ocre. Le rire naît brusquement et s’échappe de ma gorge, tandis que je manque de tomber au sol.
Notre élan devient celui d’un oiseau libre dans ces immensités. L’heure et le calendrier disparaissent, au profit de la course des nuages. Pendant mon envol, des myriades de couleurs et d’odeurs nous enveloppent, le cheval et moi. Il sait parfaitement où poser ses sabots et quel bruissement de feuille signifie un danger. Son odorat, bien plus développé que le mien, reconnaît la terre qu’il n’a jamais foulée. L’écorce des Hespérides, les nervosités du bois, le poil rêche de l’animal qui dort, l’atmosphère chargée d’orage.
Une fois à terre, je marche toujours les cinq sens en éveil. J’essaie de l’imiter sans comprendre, en savourant ce gouffre entre le sauvage indiscipliné et ma touchante maladresse d’Homme.
Je n’ai pas à parler, juste à écouter le vent, les pierres et les branchages qui craquent sous le soleil. Mon imagination d’enfant revit au travers des formes incertaines que j’aperçois au loin : serait-ce une chimère pétrifiée, sous ce grand chêne qui meurt ? Un feu follet dans cette clairière immobile ?
Tout est bien. Rien n’est parfait.
Je pense à notre vie, à son étonnante simplicité que j’affectionne tant. J’ai eu un bébé dans le ventre et deux mains nues tout autour. Nous avons construit, semé, réparé les objets et les cœurs. L’arc de mon grand-père est posé contre le mur de l’abri, au cas où la nourriture viendrait à manquer. Le sol est jonché de sciure de bois, que je me promets de ramasser demain. L’automne prochain, nous rendrons visite à nos amis.
Les fanes de carottes tombent au sol. Notre enfant les ramasse et les observe incrédule, ce qui attise la curiosité du chien, puis du chat. Les voilà assis en ronde silencieuse, affairés à une réflexion dont j’ignore tout, mais qu’ils semblent prendre très au sérieux. Drôle de spectacle pour quelques épluchures.
Mon aimé discute à l’intérieur avec nos parents. Je sors pour retrouver la fraîcheur du soir, bascule en arrière sur la couverture épaisse. Les étoiles se mêlent à la chaleur estivale. L’inquiétude s’est tarie face à la nécessité. Les questions ont laissé place au silence respectueux et au crépitement du feu. Des chants primitifs montent depuis la forêt qui borde la maison. À pas de loup, l’enfant me rejoint, tend l’oreille et répond par un sourire à ma mine perplexe. Je passe mes doigts dans ses cheveux fins.
Avant, j’écrivais pour avoir l’air aimable.
Pour faire plaisir à la maîtresse, car sans amour, pourquoi le faire ? J’écris maintenant sans motif conscient, dans un cri sombre qui illumine la nuit. Pour qui, pour quoi ? Je l’ignore. Mon esprit traverse cet étrange tunnel, où l’on croise l’ombre inerte de l’impuissance, mais aussi le tableau ardent d’Ulysse aux enfers, combattant la fatalité. Le corps actif, j’y suis encore perdue par la pensée, à chercher quelle sortie emprunter, et – surtout – ne pas le faire trop tôt, au risque de naviguer encore longtemps sur ces eaux qui coulent à l’envers.
J’écris avec la puissance de mon âme et de mes espérances, mes mains tendues vers l’horizon, ces même mains qui caressent, nouent, écrivent, dessinent, nettoient, jouent, cousent, sculptent et remuent la terre.
On continue ?



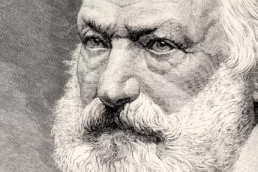
C’est si beau ma belle.
Tu m’as emmené là bas avec tes mots. ❤️
J’ai été transportée moi aussi par ta si jolie plume. ❤️